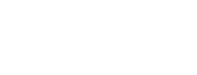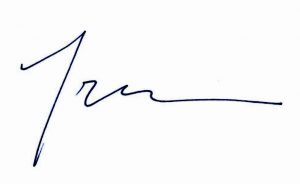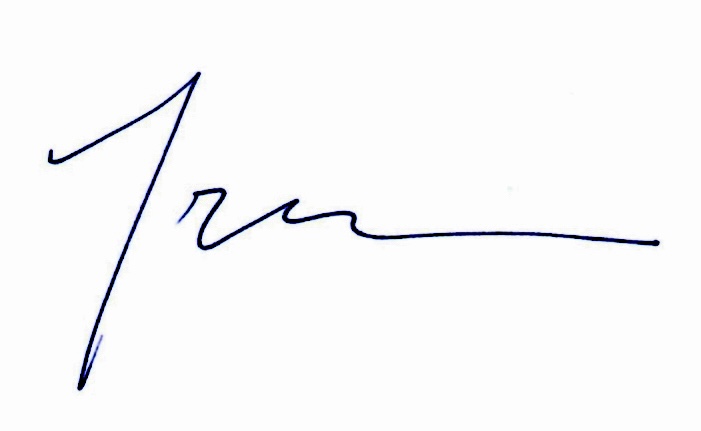Les analystes ont limité leurs critiques du discours de Jacques Parizeau à la question du vote ethnique. Pourtant, le 30 octobre 1995, en plus de nous diviser, Jacques Parizeau a proféré des menaces et incité à la violence. Puisqu’il fait partie de ces « géants » dont l’histoire a pour fonction de protéger la réputation, on vous a caché l’essentiel… jusqu’à aujourd’hui.
Dans cet extrait actualisé et augmenté de « Au nom du peuple et du fric et du sain d’esprit », mon premier livre paru en 2015, je vous raconte le côté terrifiant de ce discours incendiaire.
Devant les résultats du référendum du 20 mai 1980 sur la souveraineté du Québec, le premier ministre René Lévesque, chef du camp du OUI, disait que la victoire du NON était peu reluisante sur le plan du contenu, des méthodes, scandaleusement immorale et que, même si les règles du jeu ont été piétinées, il faut l’accepter.
Déçu et frustré par les résultats mais préoccupé par l’obligation de préserver la cohésion sociale, en leader responsable, René Lévesque a ajouté qu’il fallait continuer à vivre ensemble malgré nos divisions tout en qualifiant cet épisode d’expérience de fierté fraternelle ouverte aux autres. René Lévesque a terminé son discours en demandant à la foule d’entonner la chanson Gens du pays de Gilles Vigneault pour toutes et tous sans exception. Malgré sa déception et sa frustration, il a accepté la responsabilité de la défaite et il a livré un discours dont sont capables les grands rassembleurs.
Le deuxième référendum a eu lieu le 30 octobre 1995. Dans son discours de défaite, le chef du camp du OUI, le premier ministre Jacques Parizeau a dit, en s’adressant uniquement aux Québécoises et Québécois de souche, que la prochaine fois, au lieu d’être 61 % à voter OUI, ils devront être 63 ou 64 % et ça suffira. Puisque le référendum a été perdu par 54 288 voix, vous pouvez déduire que le premier ministre du Québec a reproché à quelques dizaines de milliers de Québécoises et Québécois de souche d’être restés écrasés dans leur sofa le soir du vote. Si son calcul est mathématiquement vrai, le propos est clairement maladroit pour toute personne qui aspire à diriger une nation en devenir, composée d’un peuple reconnu pour son ouverture à l’autre. À contrario, largement malhabile, Jacques Parizeau a admis avoir misé sur l’ethnocentrisme, le nous exclusif, le nous sans les autres.
Après avoir fait la morale à la majorité, ses semblables, n’assumant toujours pas la responsabilité de sa défaite, Jacque Parizeau s’en est pris aux autres, ses dissemblables. Il a blâmé les minorités ethniques pour avoir majoritairement voté contre la souveraineté. Cependant, si on fait abstraction du ton, des circonstances et de sa hardiesse, il a dit la vérité, énoncé une lapalissade. Mais parfois, faire preuve de sagesse, surtout quand on est déçu et frustré, c’est avoir la patience de laisser à d’autres le soin de confirmer et révéler le vrai.
Comme de fait, plusieurs études ont confirmé que les minorités ont voté majoritairement contre la souveraineté. Ce n’est pas un péché. Pour Micheline Labelle, François Rocher et Guy Rocher, « le rejet du projet indépendantiste par les minorités ethnoculturelles est lié à des intérêts économiques et à la peur de la discrimination ». Et moi, je vous rappelle qu’en démocratie, l’électorat a la totale liberté de choisir et il le fait dans le plus grand secret. Le candidat ne peut que questionner sa stratégie et son leadership pour amener le maximum d’électrices et d’électeurs à l’écouter, le comprendre et espérer l’adhésion à son camp. Ce n’est pas plus un crime de voter NON que de voter OUI. C’est un libre choix. Ceci dit…
Jacques Parizeau avait la responsabilité de convaincre les minorités que l’indépendance du Québec leur offrirait une meilleure qualité de vie et des perspectives d’avenir pour eux et leur descendance et que dans un Québec indépendant, ils seraient protégés de toutes formes de discrimination. Mais le discours accusateur et incriminant du premier ministre du Québec et son appel à l’augmentation du vote ethnocentrique des Québécoises et des Québécois de souche, avaient confirmé les pires appréhensions des membres des communautés ethnoculturelles.
Plus grave encore, Jacques Parizeau nous a poussé vers une terrifiante peur de l’autre. Il a conclu son discours par ces mots : « Et là mes amis, dans les mois qui viennent […], il y a des gens qui ont eu tellement peur que la tentation de se venger, ça va être quelque chose. Et là jamais il ne sera aussi important d’avoir à Québec ce gouvernement du Parti québécois pour nous protéger ». Mais, de qui parlait Jacques Parizeau, de qui voulait-il protéger les vraies Québécoises et les vrais Québécois, à quoi ressemblaient celles dont il fallait se méfier, ceux dont il fallait avoir peur ?
Puisqu’il avait pointé les minorités ethnoculturelles, je suis en droit de déduire que Jacques Parizeau en avait fait des boucs émissaires et des hors-la-loi. Cette idée de vengeance et le besoin de se protéger de l’autre auraient pu créer une situation explosive pour celles et ceux qu’il avait dangereusement placardés en ennemis de la nation. Je reste convaincu que quelqu’un d’autre que moi a déjà observé quelque part dans le monde des troubles sociaux, une explosion sociale, pour bien moindre mots que ça. Vous savez aussi bien que moi que les conflits naissent là où s’enflamment les maudits mots… des mots dits pour maudire.
Dans une démocratie, il est impératif que toutes et tous se sentent interpellés par un projet de société d’une telle envergure, et il revient alors aux promoteurs de ce projet de le rendre inclusif. Or, Jacques Parizeau n’a pas convaincu suffisamment de membres des communautés ethnoculturelles qu’il les considérait comme faisant partie intégrante du grand projet de faire du Québec un pays. Au contraire, le soir de sa défaite, il leur a offert les mots pour déduire et conclure de leur exclusion. Contrairement à l’électorat de souche, les gens du pays, il ne les a pas invités à voter autrement lors d’un prochain référendum. Au contraire, ce soir-là, il a laissé entendre qu’il était mathématiquement possible de faire un pays sans eux. Au mieux, malgré eux. Au pire, contre eux.
Il n’est pas nécessaire de rappeler qu’après le référendum de 1980, René Lévesque n’a pas culpabilisé ceux qui n’ont pas accepté sa proposition. Il s’est comporté en chef d’État soucieux de préserver la cohésion sociale, ce que Jacques Parizeau n’a pas fait. Ceci dit, toute analyse du référendum de 1995 doit prendre en compte le discours de démission au cours duquel Jacques Parizeau a reconnu l’incongruité de son discours de la veille.
Le lendemain de la défaite, démissionnaire, en quittant l’Assemblée nationale, Jacques Parizeau a déclaré : « Il y a une frontière que j’ai été incapable de franchir. Je n’ai pas réussi à faire en sorte qu’une proportion significative de nos concitoyens anglophones et allophones se sente solidaire du combat de leurs voisins ». C’est par cette formule que Jacques Parizeau a finalement accepté la pleine responsabilité de sa défaite… le lendemain
À moins de ne pas avoir les deux pieds sur terre, Jacques Parizeau devait savoir que pour préserver les valeurs québécoises d’ouverture et d’inclusion et maintenir la cohésion sociale, c’est ce qu’un grand rassembleur, un leader responsable, malgré la déception, le goût amer de la défaite et la frustration causée par le non-respect des règles électorales, aurait eu la décence de dire… la veille au soir.
C’est malheureusement le lendemain que Jacques Parizeau est devenu raisonnable et a dit ce qu’il fallait dire la veille, mais trop tard pour que qui que ce soit s’en souvienne… le jour d’après.